Ressources
Hôtellerie de plein air : une cartographie actualisée
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche de l’hôtellerie de plein air a conduit des travaux d’actualisation et de complément de sa cartographie des métiers.
Ces travaux s’inscrivent dans un contexte de transformation profonde du secteur et répondent à des enjeux majeurs en matière d’emploi, de compétences et d’attractivité des métiers.
Un secteur en pleine transformation
Avec 3 300 entreprises (dont 93 % de TPE) et 49 300 salariés, l’hôtellerie de plein air occupe une place majeure en Europe. En 2024, le secteur représente 141 millions de nuitées, confirmant son dynamisme.
Ces dernières années, le secteur a fortement évolué : montée en gamme des hébergements, développement des services (animation, restauration…), digitalisation du parcours client, et transition écologique.
Des enjeux forts en emploi et compétences
La forte saisonnalité (seuls 8 % des campings ouverts à l’année) et la polyvalence des équipes posent des défis importants : recrutement, fidélisation des saisonniers, professionnalisation des salariés et attractivité des métiers.
Dans ce contexte, renforcer la visibilité des métiers et accompagner les parcours professionnels constitue un enjeu stratégique pour la branche.
Une cartographie enrichie : 35 métiers recensés
Fruit d’entretiens avec des professionnels du secteur, la cartographie actualisée recense désormais 35 métiers, dont 21 nouvelles fiches, regroupés en 5 familles :
-
Direction et support
-
Accueil et réception
-
Technique et entretien
-
Loisirs et animation
-
Restauration, vente et services annexes
Un outil opérationnel pour tous les acteurs
La cartographie constitue un levier concret pour :
-
Mieux définir les besoins en compétences
-
Rédiger des offres d’emploi plus attractives
-
Identifier les passerelles entre métiers
-
Soutenir la stratégie emploi-formation de la branche
Alignée sur les référentiels ROME 4.0 et Métierscope, elle contribue à valoriser les métiers et à attirer de nouveaux talents.
>>> Consultez la cartographie des métiers de l’hôtellerie de plein air :
>>> (Re)Découvrez Ma Carrière Camping : offres d’emplois, offres de stages, témoignages de professionnels
>>> Pour aller plus loin, consultez l’étude sur l’emploi saisonnier des branches dont les activités sont liées au tourisme
La montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA), et notamment de l’IA générative, constitue un enjeu majeur pour les Organisations de Gestion de la Destination (OGD), engagées dans des missions de service public au service des territoires.
Réalisée par Matrice, cette étude a été initiée par ADN Tourisme, fédération nationale représentant plus de 1 200 OGD en France, soit environ 12 700 professionnels. Avec l'appui technique de l’AFDAS, ADN Tourisme a engagé une réflexion stratégique afin de mieux comprendre les impacts concrets de l’IA sur les métiers du tourisme institutionnel.
Une étude pour anticiper les transformations du tourisme institutionnel
L’objectif général de cette étude est d’observer et d’anticiper les effets de l’IA générative sur :
- les métiers et les pratiques professionnelles,
- les compétences attendues,
- les organisations internes,
- les modèles économiques des acteurs du tourisme institutionnel.
Cinq enseignements clés sur l’IA générative et le tourisme institutionnel
1. L’IA comme révélateur des tensions organisationnelles existantes
Les effets de l’IA ne s’inscrivent pas dans une rupture brutale ni dans une substitution massive des emplois.
Ils prolongent des dynamiques numériques déjà à l’œuvre, tout en révélant des tensions organisationnelles préexistantes.
2. Des usages déjà réels mais fragmentés
L’IA est déjà présente dans les OGD, sous une forme hétérogène et expérimentale.
Les initiatives restent souvent isolées, sans déploiement structuré à l’échelle nationale.
3. Une reconfiguration de la relation aux visiteurs
L’IA modifie la relation entre visiteurs et OGD.
Les touristes peuvent désormais arriver avec des contenus générés par IA, parfois éloignés de la réalité du territoire.
Dans ce contexte, le rôle de tiers de confiance des OGD se renforce.
4. Le véritable cœur de la transformation : la gestion des données
La capacité à intégrer efficacement l’IA dépend avant tout de la qualité des données :
- offres touristiques,
- données territoriales,
- informations clients,
- réseaux de prestataires.
Gouvernance, interopérabilité et fiabilité deviennent des enjeux structurants.
5. Les compétences à renforcer : territoire, données, relations
L’étude met en évidence un triptyque de compétences à consolider :
- connaissance fine du territoire et de ses acteurs,
- analyse et contextualisation des données,
- compétences relationnelles et communicationnelles.
Trois scénarios prospectifs à horizon 2028
L’étude propose trois trajectoires possibles :
- OGD tiers de confiance de la donnée touristique, appuyés sur des standards partagés ;
- Fragmentation des démarches et dépendance accrue aux acteurs privés ;
- Adoption pragmatique et hybride, sous contraintes budgétaires et maturités inégales.
L’étude invite à :
- tendre vers le scénario 1, en renforçant le rôle des OGD comme tiers de confiance de la donnée territoriale ;
- intégrer le réalisme du scénario 3, compte tenu des maturités hétérogènes et des contraintes RH ;
- éviter le scénario 2, qui accentuerait la fragmentation et la perte de légitimité collective.
L’IA ne remplace pas les métiers, elle déplace le travail
L’IA générative ne remplace pas les métiers des OGD : elle en déplace le centre de gravité.
Elle accélère certaines tâches, mais accroît surtout les exigences de fiabilité, de médiation et de responsabilité.
Dans un contexte où l’information circule vite, parfois de manière erronée, les OGD voient leur rôle stratégique se renforcer : celui de garants de la donnée touristique territoriale, au service des visiteurs, des partenaires et des territoires.
>>> Consultez le rapport et la synthèse de l'étude Impact de l’IA sur les métiers du tourisme au sein des Organisations de Gestion de la Destination (OGD) :
Ces dernières années, l’exploitation cinématographique a connu de profondes mutations. Numérisation des équipements, évolution des usages et des attentes du public, crise sanitaire, prise en compte des enjeux environnementaux : autant de facteurs qui ont redéfini l’organisation des salles de cinéma et les compétences mobilisées au quotidien.
Dans ce contexte de transformation accélérée, la branche de l’exploitation cinématographique, avec l’appui de l’Afdas, a engagé une étude stratégique afin de mieux comprendre les évolutions à l’œuvre et d’anticiper les besoins futurs en emplois et en compétences.
Pilotée par la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), réunissant les organisations syndicales de salariés et d’employeurs avec l’appui technique de l’Afdas, et réalisée par le cabinet Obéa, cette étude repose sur une analyse documentaire approfondie et sur une trentaine d’entretiens menés auprès de professionnels représentant la diversité des métiers des salles de cinéma.
L’objectif est double : dresser un état des lieux actualisé des métiers et compétences, et fournir des clés de lecture partagées pour accompagner durablement les transformations du secteur.
Deux enjeux majeurs se dégagent
-
Adapter les métiers aux nouveaux enjeux : certains postes traditionnels évoluent, voire disparaissent, tandis que de nouvelles expertises émergent, notamment en marketing digital, analyse de données ou technologies immersives.
-
Réinventer les pratiques RH : concilier flexibilité organisationnelle et fidélisation des talents, gérer la polyvalence tout en développant des spécialisations ciblées et stratégiques, constitue un défi central pour les exploitants.
Trois constats clés issus des travaux
-
La transformation des métiers techniques.
La numérisation des équipements a profondément modifié les techniques de projection. Le métier de projectionniste a évolué vers celui de technicien polyvalent, combinant compétences audiovisuelles, informatiques et de maintenance. Pour autant, la numérisation ne signifie pas automatisation complète : l’intervention humaine reste essentielle pour la qualité de l’image, du son et des réglages.
-
La montée en polyvalence.
Particulièrement marquée dans les petites et moyennes exploitations, la polyvalence est devenue une réalité structurante. Les frontières entre technique, accueil et gestion s’estompent, un même salarié pouvant intervenir sur plusieurs dimensions de l’activité.
-
L’enjeu de valorisation des salles.
Face à la concurrence des autres pratiques culturelles, les cinémas réaffirment leur rôle de lieux d’expérience collective, de médiation culturelle et de lien social. L’émotion partagée et la convivialité constituent un atout différenciant majeur pour le secteur.
Quatre grandes familles de métiers
La cartographie des métiers permet d’établir un état des lieux précis des fonctions, responsabilités et compétences mobilisées aujourd’hui. Elle permet d’identifier les profils clés, de repérer d’éventuelles tensions de recrutement et de mieux comprendre les dynamiques professionnelles du secteur.
Elle répertorie 21 fiches métiers contenant description, missions principales, savoir-faire, savoir-être, savoirs, voies d’accès et environnement de travail. Quatre grandes familles de métiers se dégagent.
-
Les métiers de l’accueil, au cœur de l’expérience spectateur. L’agent de cinéma devient un facilitateur d’expérience, orienté vers le conseil personnalisé et la relation client.
-
Les métiers de la technique, de la maintenance et de la sécurité, garants de la qualité de diffusion et du bon fonctionnement des équipements.
-
Les métiers de l’encadrement et de la gestion de site, regroupant assistants, responsables et directeurs, avec des parcours d’évolution désormais bien identifiés.
-
Les fonctions « Siège et support », incluant notamment le programmateur – métier spécifique à la branche – ainsi que les fonctions transverses (Marketing, RH, RSE), surtout présentes dans les structures de grande taille.
À la fois analytiques et opérationnels, les résultats de l’étude et la cartographie des métiers fournissent à la branche de l’exploitation cinématographique des repères partagés et des leviers concrets pour s’adapter avec agilité et renforcer sa pérennité dans un environnement en constante évolution.
>>> Consultez le site de la cartographie des métiers de l’exploitation cinématographique
>>> Retrouvez le rapport et la synthèse des travaux sur la cartographie des métiers de l’exploitation cinématographique :
La 3e édition de l’enquête des Besoins en Métiers et Compétences (BMC) menée par l’Afdas, fondée sur les données collectées en septembre / octobre 2025 auprès de 9 380 entreprises, dresse un état des lieux nuancé des dynamiques d’emploi dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.
Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et budgétaires, les intentions de recrutement reculent, sans pour autant effacer les besoins structurels en compétences.
1 répondant sur 3 envisage au moins un recrutement en 2026.
Cette baisse par rapport aux éditions précédentes traduit une forme d’attentisme, renforcée par une visibilité économique limitée.
>>> Pour aller plus loin : consultez les enquêtes Besoins en métiers et compétences 2023 et 2024
Pour autant, l’enquête recense un volume significatif de projets (48%) portés par des entreprises et structures de moins de 11 salariés.
Les formes d’emploi restent fortement marquées par la saisonnalité et les contrats courts, en particulier dans le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie de plein air.
- En 2025, 34% des répondants anticipent de recruter en 2026
(En 2024, 51% des répondants anticipaient de recruter en 2025) - 54% des recrutements concernent des emplois saisonniers, une part en forte hausse (30% lors de l’édition précédente).
- 52% des projets relèvent des métiers en lien avec les relations aux publics, clients et visiteurs.
Les difficultés de recrutement, bien qu’en léger recul, restent élevées.
Elles s’expliquent d’abord par l’inadéquation entre les profils disponibles et les compétences attendues, mais aussi par des conditions de travail jugées atypiques ou une localisation peu attractive.
Certains secteurs comme la publicité, la presse ou les télécoms, concentrent des tensions particulièrement fortes.
- 41% des recrutements sont jugés difficiles par les employeurs.
L’enquête met en lumière des transformations profondes des besoins en compétences.
Les employeurs recherchent en priorité des compétences techniques « cœur de métier », mais la maîtrise des outils numériques progresse fortement, tout comme l’intérêt pour l’intelligence artificielle, encore inégalement réparti selon les secteurs. Ces évolutions confirment le rôle central de la formation pour accompagner les transitions en cours et sécuriser les parcours professionnels dans des secteurs en constante mutation
- 65 % des répondants déclarent vouloir renforcer les compétences de leurs équipes, par la formation ou le recrutement (63% en 2024 pour 2025)
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’EDEC (Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences) intersectoriel Afdas. Il a été signé par le ministère du Travail et des Solidarités, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de la Culture, les 31 branches professionnelles des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement et par l’Afdas, afin d’accompagner les branches professionnelles et répondre à leurs enjeux de maintien et de développement des compétences des entreprises et des salariés.

>> Consultez les résultats par secteurs et régions
>> Retrouvez le rapport de l’enquête 2025 :
Quel avenir pour les activités des secteurs de la culture, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement ?
Impacts des évolutions socio-culturelles sur les attentes des publics et les activités des secteurs
Les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement font face à une accélération durable des évolutions sociales et démographiques, en même temps qu’à l’émergence de nouvelles valeurs qui influent sur les pratiques culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, les choix de consommation et le rapport au travail.
L’analyse, confiée au cabinet Sociovision, précise les évolutions majeures qui bouleversent à la fois les attentes des publics et l’organisation des activités professionnelles.
Des publics plus exigeants et une fragmentation qui s’accentue
Vieillissement démographique, baisse de la natalité, montée en puissance des générations Z et Alpha : les profils se diversifient et les attentes se complexifient.
Les plus jeunes construisent leurs références culturelles majoritairement via les réseaux sociaux et les plateformes numériques, tandis que les seniors gagnent en poids et expriment des besoins spécifiques en matière d’accessibilité, de médiation et de formats.
- Les naissances baissent de 21,5 % entre 2010 et 2024
- 45 % des foyers seront composés d’une seule personne en 2035
- 45 % des Français estiment que leur vie manque de sens
Des pratiques culturelles et de loisirs en recomposition
Sous l’effet combiné de la numérisation et des arbitrages budgétaires des ménages, les Français privilégient la consommation de services et de produits culturels à domicile.
Lorsqu’ils se déplacent, ils attendent désormais des expériences plus rares, plus différenciantes et plus émotionnelles.
L’hybridation entre physique et numérique devient la norme : formats immersifs, expériences interactives, scénographies augmentées ou événements « phygitaux » redéfinissent la relation au public.
- 60 % des Français évitent les sites touristiques très fréquentés
- 68 % pratiquent un sport au moins une fois par mois en 2025
- 60 % regardent des contenus vidéo en streaming chaque semaine
Des entreprises sous pression économique et technologique
L’inflation des coûts, les tensions sur les subventions publiques, la nécessité d’investir dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle fragilisent les modèles économiques existants, en particulier les plus petites structures.
Les contenus sont de plus en plus influencés par les algorithmes, la recommandation automatisée et les plateformes, accentuant la dispersion des audiences et la concurrence pour la visibilité.
La création humaine, la diversité culturelle et les repères éditoriaux deviennent des enjeux centraux à préserver.
- L’intérêt des Français baisse de 11 points sur les responsabilités environnementales et sociales des entreprises
- 56 % trouvent normal l’usage de chatbots par les entreprises
- 82% sont contre l’idée que des IA remplacent les acteurs/actrices
Le travail et les compétences au cœur des transformations
Enfin, la transformation du monde du travail constitue un axe structurant de cette prospective.
L’intégration rapide de l’IA, la montée des enjeux de santé mentale, l’évolution des rapports professionnels dans la continuité de #MeToo et la nécessité de pratiques managériales plus inclusives imposent une refonte des organisations.
Les compétences hybrides, à l’interface entre créativité, technologie, médiation et sens critique, deviennent stratégiques.
- 62% des jeunes de 25-34 ans sont prêts à sacrifier leur travail pour privilégier leur vie privé
Vers un nouveau pacte entre les acteurs économiques et leurs publics, clients et visiteurs
À l’horizon 2035, la réussite économique et professionnelle des entreprises et de leurs salariés reposera sur leur capacité à recréer un lien durable, d’émotion et de confiance dans une société plus fragmentée, mais où les publics, clients et visiteurs sont en quête de sens.
Plus qu’une adaptation technique, c’est un véritable changement de regard que les entreprises et salariés doivent porter sur les usages, les valeurs et les nouvelles attentes sociétales qui se dessinent, appelant à des modèles plus responsables, plus inclusifs et plus ancrés dans les territoires.
Cette action d’analyse des Pratiques et choix de consommation dans les champs sectoriels de l’Afdas s’inscrit dans le cadre de l’EDEC (Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences) intersectoriel Afdas. Il a été signé par le ministère du Travail et des Solidarités, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de la Culture, les 31 branches professionnelles des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement et par l’Afdas, afin d’accompagner les branches professionnelles et répondre à leurs enjeux.

>>> Consultez le rapport et la synthèse de l'étude prospective intersectorielle Horizon 2035 - Sociovision - Afdas :
Le guide des compétences du numérique responsable
Découvrez les métiers et compétences professionnelles respectueuses de l'environnement et socialement responsables, grâce au guide complet de la branche professionnelle des télécoms.
Ce document accompagne les entreprises et salariés dans la réduction de l'impact écologique du numérique et contribue à une transformation digitale durable.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) intersectoriel de l’Afdas. Il a été signé par le ministère du Travail et des Solidarités, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de la Culture, les 31 branches professionnelles des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement et par l’Afdas, afin d’accompagner les branches professionnelles et répondre à leurs enjeux de maintien et de développement des compétences des entreprises et des salariés.

Une étude sur l’impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences de la branche du sport au sein de l’ESS vient d’être publiée.
Objectif : Anticiper les mutations de l’emploi liées à la transition écologique dans la branche du sport associatif, hors sport marchand et professionnel.
Menée dans le cadre de l’EDEC « Objectifs Transitions 2025 », élaborée par Pluricité & Sport 1.5, et cofinancée par l’Etat, l’AFDAS et l’UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire), elle repose sur une large collecte de données qualitatives et quantitatives auprès de plus de 850 employeurs et structures sportives, enrichies par une trentaine d’entretiens et des analyses documentaires.
Le rapport montre que la transition écologique transforme en profondeur le sport associatif et révèle une prise de conscience croissante, 72 % des structures considèrent désormais la transition écologique et énergétique comme un enjeu majeur, mais encore inégale selon les disciplines (indoor ou outdoor).
Contrairement à d’autres secteurs, le sport ne verra pas émerger massivement de nouveaux métiers dédiés à la transition écologique et énergétique. En revanche, les professions existantes doivent évoluer, avec quatre compétences clés à renforcer :
- Techniques et organisationnelles (compréhension des écosystèmes, gestion de matériel durable, évaluation des impacts).
- Transversales (coopération territoriale, communication responsable, pédagogie).
- Comportementales (adaptation aux publics, gestion du changement).
- Stratégiques (intégration de la transition écologique et énergétique dans la planification et le développement associatif).
La formation apparaît alors comme le levier central pour accompagner ce mouvement, avec la nécessité de bâtir un socle commun et de diffuser une culture écologique partagée.
Pour ancrer la transition écologique dans le sport associatif, le rapport propose une feuille de route opérationnelle :
- Construire un socle commun : Fédérer les acteurs du sport autour d’une culture partagée de la transition écologique, en harmonisant les repères, les outils et les compétences nécessaires pour agir efficacement.
- Massifier la formation et l’adapter : Faire de la formation un levier de transformation en déployant des parcours modulaires pour s’adapter aux réalités opérationnelles des professionnels du sport et progressifs pour être accessibles à tous, quel que soit leur niveau de maturité écologique.
- Développer des modules techniques spécialisés : Renforcer la capacité d’agir sur le terrain grâce à des formations concrètes, centrées sur les gestes, les pratiques et les savoir-faire adaptés aux spécificités de chaque sport et de chaque territoire et favorisant l’autonomie, la résilience et l’échange de pratiques.
- Structurer la gouvernance et pilotage : Mettre en cohérence les politiques publiques, les dispositifs de financement et les dynamiques territoriales et aligner les ambitions des acteurs du sport en matière de transition écologique dans l’organisation des activités physiques et sportives.
- Anticiper l’avenir des métiers : Continuer les travaux prospectifs pour préparer dès aujourd’hui les transformations de demain, en explorant les impacts à long terme du changement climatique sur les métiers, les équipements et les modèles économiques du sport.
Il souligne également la nécessité d’une coordination durable entre les acteurs du sport, de la formation et des politiques publiques pour inscrire la transition écologique dans l’évolution concrète des métiers et des pratiques.
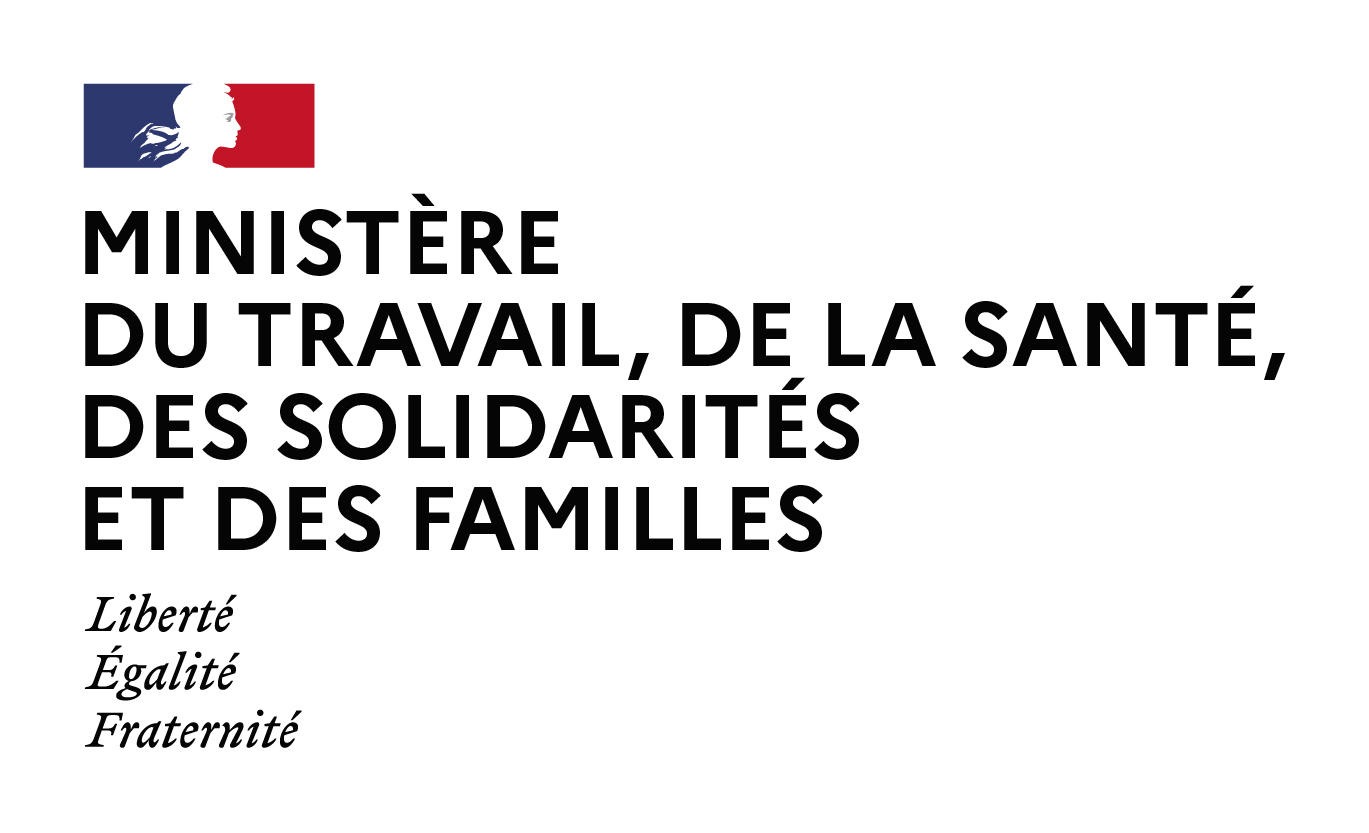
>>> Consultez le rapport, sa synthèse ainsi que l’infographie :
La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) de l’audiovisuel, en partenariat avec l’Afdas, a conduit une étude d’opportunité en vue de la création d’une certification professionnelle "Coordinateur·rice d’écoproduction" confiée à Paradoxes Conseil.
Objectif : reconnaître et professionnaliser un métier en plein essor, au cœur de la transition écologique du secteur audiovisuel.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) intersectoriel « Culture, industries créatives, médias, communication, télécommunications, sport, tourisme, loisirs et divertissement », porté par l’Afdas.
Un métier émergent au service de la transition écologique de l’audiovisuel
Avec une empreinte carbone estimée à 1,7 million de tonnes d’équivalent CO₂ par an, le secteur audiovisuel fait face à des enjeux environnementaux majeurs. Les productions s’engagent progressivement dans des démarches écoresponsables, soutenues par les politiques publiques, les labels et les exigences du CNC (Centre National de la Cinématographie).
Dans ce contexte, le Coordinateur·rice d’écoproduction accompagne les équipes de production pour intégrer les pratiques durables à chaque étape des projets audiovisuels, tout en veillant à la cohérence entre ambitions environnementales et contraintes artistiques, techniques et économiques.
Une étude pour analyser les pratiques et structurer le métier
L’étude a mobilisé une analyse documentaire approfondie, des enquêtes de terrain auprès de coordinateurs, de directeurs de production et d’experts, ainsi que des groupes de travail associant des professionnels de l’écoproduction et les conseillers emploi-formation de l’Afdas.
Les résultats montrent que le métier, encore en construction, se caractérise par une grande diversité de profils et d’appellations (coordinateur·rice, chargé·e d’écoproduction, impact manager…). Il requiert une double expertise : une solide connaissance des métiers de la production audiovisuelle et une maîtrise des enjeux environnementaux et du développement durable.
La création d’une certification permettra de mieux définir les contours du métier, d’harmoniser les pratiques professionnelles et de valoriser les compétences nécessaires à son exercice.
Vers une reconnaissance officielle du métier
La CPNEF de l’audiovisuel a décidé d’engager la création d’une certification "Coordinateur·rice d’écoproduction".
Une demande d’inscription sur la liste des métiers émergents ou en évolution a été déposée auprès de France Compétences.
L’objectif est de former les premiers professionnels certifiés dès 2027.
>>> Consultez le rapport et la synthèse de l’étude d’opportunité pour la création d’une certification "Coordinateur·rice d’écoproduction"
La CPNE du Golf a réalisé une étude d’opportunité pour la création d’une certification professionnelle "Jardinier de terrain de golf".
Objectif : mieux former et reconnaître les professionnels qui entretiennent et valorisent les parcours de golf partout en France.
Cette étude s’inscrit dans la volonté de la branche de professionnaliser durablement les métiers du terrain et d’accompagner la transition écologique du golf en France.
Des métiers essentiels au cœur des parcours
Avec plus de 445 000 licenciés en 2023 et 730 structures golfiques, le golf poursuit sa croissance et sa démocratisation. Les métiers du terrain — jardiniers, mécaniciens, fontainiers, intendants — représentent près de 40 % des salariés du secteur. Ces professionnels jouent un rôle clé dans la qualité du jeu, la préservation des écosystèmes et l’attractivité des golfs.
Adapter les compétences aux nouveaux défis environnementaux
Face à la transition écologique, les pratiques d’entretien évoluent : gestion raisonnée de l’eau, réduction des produits phytosanitaires, entretien durable et protection de la biodiversité. Ces changements nécessitent de nouvelles compétences que l’offre de formation actuelle ne couvre plus entièrement.
3 domaines d’activités constituent le cœur du métier de jardinier de golf :
- Les activités d’entretien du terrain de jeu et des abords des parcours
- Les activités d’entretien et de nettoyage de ses outils et équipements
- Les activités d’organisation et de transmission d’informations
Des facteurs d’évolution
Le métier de jardinier de golf se situe au carrefour de multiples évolutions qui viennent impacter ses conditions d’exercice, les activités qui lui sont confiées ainsi que les compétences nécessaires à leur réalisation :
- Transition écologique
- Évolutions techniques et technologiques
- Évolution du nombre de joueurs, diversification des profils de joueurs ou évolution de l’offre de services des structures
>>> Consultez le rapport et la synthèse de l’étude d’opportunité pour la création d’un CQP "Jardinier de terrain de golf" :



